Un mouvement naturel d’orientation compose la géométrie de base : on regarde autour de soi sans exprimer un jugement, tout simplement pour comprendre où l’on se trouve et avec qui. A partir de là les choses qu’on y imagine, les désirs, les souvenirs ont un poids aussi grand que les objets présents à l’écran. Cet imaginaire relance l’image vers un niveau qui est entre la fiction et le documentaire. Ou bien qui n’appartient ni à l’une ni à l’autre.
« Se voir autre pour se voir soi-même »
Pas de véritable histoire, pas de portraits au sens traditionnel du terme, pas de contemplation ou même d’observation d’une réalité, les films de Cioni se dérobent à toute catégorisation. Ils sont composés de différents domaines – on y retrouve un peu de sociologie, des fragments d’Histoire, beaucoup de sémiotique – mais ils ne se laissent pas caser. Un mouvement perpétuel – peut-être le résultat d’un esprit nomade – les anime.
Italien, né en France et ayant grandi à Bruxelles, Cioni a vécu – et vit encore – entre deux cultures, deux patries, deux langues sans jamais appartenir véritablement à l’une des deux. Bien plus que son ami Claudio Pazienza, il est l’entre deux : l’Ulysse qui n’est jamais retourné chez lui et trouve sa véritable identité dans un retour toujours prolongé. Dans tous ses films une question revient sans cesse : où est-ce que je suis ?
C’est dans le visage de l’autre que Cioni trouve une réponse possible. Face à l’incertitude du « je », l’autre – avec son histoire, sa culture, sa langue, son imaginaire – devient une sorte d’abri sous lequel monter sa tente. Cela est évident dans Nous / Autres, présenté à VdR en 2003, une sorte de manifeste esthétique et éthique de son art.
D’abord, le sujet qui devient pluriel, le « nous » au lieu du « je » du cinéma ethnographique. Les autres entrent dans cette démarche en tant qu’élément interne à la communauté. C’est à partir de cette dialectique d’inclusion et de distanciation que Cioni conçoit ses films. Cette perspective se traduit dans une approche tout à fait singulière : Cioni n’a pas du tout l’attitude du documentariste qui affirme sa position en regardant les autres ; il n’est pas intéressé non plus à reproduire la rencontre d’une façon directe, tant il est vrai qu’il trouve à chaque fois un dispositif qui relance la scène à un autre niveau. Cela arrive souvent par le biais de la fiction : l’emploi de textes écrits à l’avance, des comédiens qui s’emparent de la parole des témoins, des scènes répétées en face de la caméra… Quand on regarde un documentaire on a l’impression que la réalité préexiste au regard du cinéaste ; quand on regarde un film de Giovanni Cioni on a l’impression que la réalité se construit devant nos yeux, dans le mouvement même du film.
« Mes films sont toujours à inventer »
Pour réaliser un film, il faut d’abord dissoudre le lien ordinaire, celui qui lie un objet à son emploi ou une personne à son milieu. Il faut trouver d’autres relations. Pour ce faire, Cioni a beaucoup travaillé la contamination avec les autres arts : le mouvement abstrait de la danse contemporaine, la construction d’un espace fictif propre au théâtre, la définition d’un geste ou d’une expression des arts plastiques font désormais partie de son langage. Avant et à côté des longs-métrages il a réalisé des films expérimentaux qui l’ont amené à épurer son discours.
Que ce soit dans une forme directe comme dans Témoins Lisbonne août 2003, ou à l’intérieur d’une composition comme dans La Rumeur du monde, la matière est toujours présente à l’écran. Le grain des objets (les crânes dans In Purgatorio), la couleur des décors (les costumes dans Lourdes Las Vegas), la texture des lieux filmés (la maison vide dans Nous / Autres) relèvent d’un rapport intime avec tout ce qui appartient au réel. Mais cette intimité se définit à travers le filtre du regard, un regard qui – en se nourrissant des films portugais (de Paulo Rocha à Joao Botelho, sans oublier Manoel de Oliveira) et japonais (de Oshima à Ozu) – a appris à percer l’invisible dans le visible. In Purgatorio reste jusqu’à présent le meilleur exemple de cette attitude. Certes, le choix d’une ville comme Naples où le revenant, le fantôme, l’ange ou le diable surgissant à chaque coin de rue a beaucoup aidé. Il n’en reste moins vrai que Cioni a réalisé un film où la ville elle-même semble être une création de l’esprit. Il suffit de regarder le travail sur la bande son pour saisir combien le rêve est partie prenante dans le projet. C’est un cinéma prophétique, capable de voir au-delà de la réalité, de poser des questions sans délivrer de réponses, celui vers le quel Cioni se penche.
« Il faut écouter un film »
Prenons Lourdes Las Vegas, un film où la parole vient d’un texte écrit et mis en scène à l’avance, un film où le cadrage est parfois surprenant, tant il bouleverse l’idée préconçue de « pièce filmée ». En dépit de sa musique bruyante, des ses métaphores (la vierge, l’enfant…), de toute une théorie de costumes, maquillage et gestes, le film frappe pour son silence. C’est un silence qui appartient à un autre niveau que celui de la réalité filmée et qui traduit la solitude métaphysique des personnages. C’est un silence qui se nourrit du bruit – un peu comme les rares moments de suspension auxquels se livre l’affabulateur Jan dans Nous / Autres.
Le silence est indispensable non seulement pour deviner l’identité du personnage, mais aussi pour permettre au spectateur de prendre place dans le récit. Autrement dit : le silence est une question d’écoute. Et l’écoute crée le hors champs de l’image. C’est-à-dire qu’il laisse la porte ouverte à nos désirs ainsi qu’à notre imaginaire.
Fils du cinéma moderne, Cioni s’ouvre à des sujets qui ne lui appartiennent pas (une pièce de théâtre, des exilés de la seconde guerre mondiale, une ville qu’il n’avait jamais vu auparavant) ; il filme des personnes pour tisser des liens ; il fabrique ses films en montage après avoir écouté les images et saisi le rythme qui les rend vivantes. Cette énergie, que le travail du montage cherche à traduire, permet au film d’être une expérience du monde. Mais cela est possible à une condition, car le monde existe dans la pluralité du sujet et dans le partage. Si faire un film veut dire faire expérience du monde, trouver sa place dans le monde, c’est parce que le film lui-même s’inscrit dans un parcours de définition de l’identité qui concerne le cinéaste au même titre que les personnes qu’il rencontre, personnages et public.
Pages: 1 2
 03.12.2024: DICEMBRE 2024
03.12.2024: DICEMBRE 2024 09.05.2024: PAROLE TREMANTI, L’ORTO DEL MONDO e UNA GRANDE VITA LUNGA
09.05.2024: PAROLE TREMANTI, L’ORTO DEL MONDO e UNA GRANDE VITA LUNGA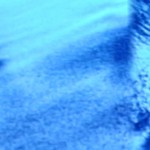 31.01.2024: febbraio 2024 L’ORTO DEL MONDO e IL MIO NOME È NESSUNO
31.01.2024: febbraio 2024 L’ORTO DEL MONDO e IL MIO NOME È NESSUNO 18.10.2023: DAL PIANETA DEGLI UMANI attraverso il pianeta (seguito)
18.10.2023: DAL PIANETA DEGLI UMANI attraverso il pianeta (seguito) 17.03.2023: L’ORTO DEL MONDO, un laboratorio di cinema del reale, maggio giugno 2023
17.03.2023: L’ORTO DEL MONDO, un laboratorio di cinema del reale, maggio giugno 2023 19.08.2022: DAL PIANETA DEGLI UMANI, Buenos Aires, Argentiera, FRONTLAB, Cinemancia Antioquia
19.08.2022: DAL PIANETA DEGLI UMANI, Buenos Aires, Argentiera, FRONTLAB, Cinemancia Antioquia